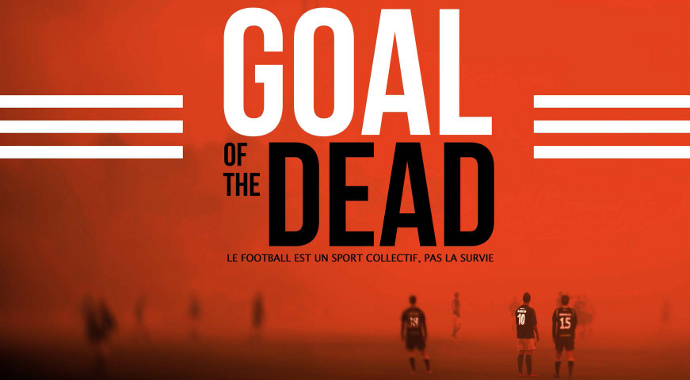Life of Mariko in Kabukicho : le coup de la panne
Bon, c’était quoi encore le film de 14h que j’ai été voir hier ? Ah oui, Life of je sais pas quoi là. Attends, je vais aller voir sur l’appli du BIFFF comment ça s’écrit. OK, Life of Mariko in Kabukicho. Le fameux. Mais pourquoi j’ai été voir ce film ? Normalement c’est Vincent qui se tape tous les films japonais incompréhensibles. Parfois, je me désespère. Bon OK, allez Olivier, on se motive. Qu’est-ce que je peux dire dessus ? Rho mais j’en sais rien, j’ai pas d’inspi là. Laisse tomber, je suis arrivé avec 10 minutes de retard dans la salle avec une gueule de bois plus grande que l’implication de la Reine Elizabeth II dans la mort de Diana. Ahahah, ouais je vais pas la mettre dans la chronique celle-là, c’est encore un peu tôt. En plus j’ai raté la fin puisque j’avais l’interview de Barry Sonnenfeld et c’est pas les 10 minutes que j’ai rattrapées en salle de presse trois heures plus tard qui vont me servir à quelque chose. Bon, si je ne raconte pas l’histoire, je dois trouver un concept pour la chronique. Que ce soit un peu original, drôle sans pour autant me faire passer pour un clampin paresseux qui n’avait pas envie de parler du film. Tiens, et si je faisais ma chronique comme une recette de cuisine ? Non merde, je l’ai déjà fait il y a quatre ans celle-là. L’écrire comme si c’était un épisode de Koh Lanta ? Mais non, je suis con je l’ai fait l’an dernier. Faire un roman photo ? Rho mais non on l’a fait avec Loïc pour Selfie from Hell. C’était marrant d’ailleurs. Tiens, je vais me la remater sur le site.
Bon, avec tout ça je suis pas beaucoup plus avancé. Mais allez il doit bien y avoir quelque chose d’intéressant à dire sur ce film. Ça parlait de quoi déjà ? Ah oui plusieurs histoires liées pour des personnes qui fréquentent un bar au Japon et on va les suivre l’un après l’autre. Mais quelle idée toute naze. Remarque, tu ferais la même au BIFFF et tu le diffuserais à la fin du festival ce serait le feu. Ou bien tu mets une GoPro à Stéphane et tu le suis pendant toute la journée comme ça à chaque film qu’il présente on connaît exactement son taux d’alcool. Ça s’est pas mal comme concept. Je le note pour une prochaine chronique.
Bon, je tente.
Life of Mariko in Kabukicho ou les chroniques des alcooliques anonymes version japonaise. Non c’est nul ça.
Vous ne vous êtes jamais demandés ce que font les gros pochtrons du coin quand ils ne vident pas leurs demi de Stella au bar tout naze à côté de la gare ? Mais non c’est de la merde ça.
Fais chier, j’ai pas d’inspi pour celui-là. C’est la fin du BIFFF c’est chaud. Ou bien j’utilise mon joker « J’ai rien compris. » J’y ai droit une fois par an après tout et cette année je ne l’ai pas encore utilisé. Ouais mais non, demain on va voir un film à 00h45 et c’est encore moi qui vais devoir faire la chronique puisque Loïc va dormir sur mon épaule. Et si on a enchaîné les Trolls avant, il sera bien utile le joker. Je vais quand-même pas raconter le film sérieusement. Faut pas décevoir les stagiaires du BIFFF qui sont à peu près les seuls à nous lire avec Jonathan. Tiens d’ailleurs, il faut que je me rappelle de les remercier tous parce qu’ils ont fait un travail de dingue cette année.
Ah mais oui, je sais ! Pourquoi j’y ai pas pensé plus tôt ?! Ok ça va être magique, ça va être la meilleure chronique du BIFFF !
Bon, c’était quoi encore le film de 14h que j’ai été voir hier ? O.E.

The black minutes : ambiance très nwaar
Librement adapté du roman de Martin Solares, The black minutes est un film noir qui nous plonge dans le Mexique des années 70, ses réseaux de pouvoir, sa corruption endémique et sa violence. Une situation qui n’a malheureusement pas évolué depuis et qui nous fait malheureusement dire que le nouveau film de Mario Muñoz est une excellente illustration de l’état dans lequel se trouve son pays à l’heure actuelle.
Golfe du Mexique, années 70. Dans une petite ville pétrolière, une série de meurtres de jeunes filles brutalement mutilées laisse la police locale depuis des mois indifférente. Mais lorsqu’une jeune journaliste propose des informations au seul flic relativement intègre de la ville, les choses s’emballent. Car la piste qui mène vers celui que l’on nomme le Chacal conduit tout droit vers les hautes instances municipales. Invité à regarder ailleurs, Vincente Rangel sait qu’en poursuivant son enquête, il risque gros.
Adapter un roman à l’écran n’est jamais une chose aisée et même si Mario Muñoz réussit à créer une atmosphère digne d’un grand film noir, celui-ci n’est pas exempt de quelques défauts, et notamment d’une fin que certains jugeront trop abrupte. Néanmoins, si le film ne nous a pas totalement convaincu, il contient de nombreux éléments dignes d’intérêt et il serait dès lors dommage de passer à côté.
Comme mentionné ci-dessus, The black minutes c’est en premier lieu un film dont l’ambiance noire et poisseuse vous colle à la peau, résultat d’un excellent travailleur du directeur de la photographie, d’une magnifique bande son et d’un scénario déprimant qui exclue toute fin heureuse. C’est également une œuvre au message politique fort, dénonçant la corruption endémique qui gangrène le pays depuis des dizaines d’années et laisse les citoyens devant un choix impossible.
Au vu des qualités intrinsèques du film, on ne peut qu’être déçu par cette fin qui nous laisse orphelin. Un voile noir qui retombe sur le Mexique et nous pousse à croire que le cycle de violence est amené à se prolonger indéfiniment. V.P.

Summer Scars : tube de l’été
Il était une fois deux frères. Deux fauves, deux trous dans l’cerveau, poto, deux paires. Conditionnés au fond d’un hall sur une chaise. Emprisonnés, des rêves qui brisent plus d’une chaîne. Esprit de gosse caché derrière le V. Pris d’ambition en stagnant d’vant L.V. Salaire de bacqueux chaque soir dans les Nike. Bénéf’ de la beuh qui part dans le mic’. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans l’ciel, pas plus d’une étoile, en face du trône. Des grammes, des kill’s de peine, même dans le bend’. Deux frères, deux fauves, le M.
Si Ademo et N.O.S. nous racontaient avec brio un amour fraternel dans Deux Frères, Summer Scars pourrait être un biopic conceptuel des deux rappeurs de PNL. Revenus dans leur maison d’enfance pour enterrer leur père, Tony et Noé reviennent aussi sur les lieux où Tony a eu un accident mortel lorsqu’ils étaient jeunes. Et comment qu’est-ce que c’est possible qu’il soit encore là alors ? Me direz-vous. Eh bien parce que Noé, sous ses apparences taiseuses, cache une âme de prince charmant de Disney. Je ne vous en dirai pas plus mais si vous n’avez pas compris ce dont il s’agit, il s’agirait d’arrêter l’alcool pour un petit temps. Après tout, le BIFFF 2023 c’est dans 7 mois seulement. Une petite cure de désintox et hop, le tour est joué.
Avec ses couleurs chaudes, son rythme lancinant et son jeu d’acteur très brut mais juste, ce Summer Scars ressemble à un mélange entre nos vacances estivales de jeunesse et les actuelles. Basé sur un concept original, le film ne se repose heureusement pas uniquement sur celui-ci et part explorer de nouvelles contrées scénaristiques avant qu’il ne s’épuise, ce qui est le bienvenu (poke à Blast et Nightride). Simon Rieth nous propose ici un conte d’été à la fois poétique, violent et sobre mais prenant. Une belle surprise pour un film qui a été présenté à la semaine de la critique à Cannes. Mashallah ! O.E.

Diabolik : Vivement le 2
Adaptation d’une des BD les plus vendues au monde avec plus de 150 millions d’exemplaires écoulés, Diabolik est, malgré le fait que paraissent encore chaque mois de nouveaux épisodes de la série, une dose de nostalgie que l’on ne peut que vous conseiller de consommer sans modération. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, deux autres films sont prévus par les frères Manetti pour compléter cette trilogie.
Clerville, qui n’est rien de moins qu’un Gotham City italien, est en prise avec un fléau masqué du nom de Diabolik, un criminel sans foi ni loi, maître dans l’art du déguisement et surtout, un citoyen bien comme il faut qui mène une double vie… Lorsque Eva Kant, veuve d’un riche homme d’affaires sud-africain, débarque en ville, l’inspecteur Ginko – ennemi juré de Diabolik – la met en garde. Elle pourrait être la prochaine cible de notre talentueux cambrioleur. Mais pour Eva, l’attrait du grand frisson est sans doute plus fort et attirant que ces tristes conseils de prudence.
Influencé par le personnage de Fantomas, le personnage de Diabolik, créé en 1962 par les sœurs Angela et Luciana Giussani s’en différencie par son côté glamour et, en comparaison avec l’adaptation très libre avec Jean Marais et Louis de Funès, son absence d’humour. Et même si Diabolik perd le personnage de Fandor et fait glisser celui d’Hélène dans le camp du crime, on peut affirmer que cette adaptation est sans doute plus proche de l’original de Pierre Souvestre et Marcel Allain que celle réalisée par André Hunebelle dans les années 60.
Surfant sur la vague rétro, Les frères Manetti nous propose un film à l’esthétique léchée, qui par certains aspects nous rappelle les aventures The Saint – dont la première série a été diffusée en 1962 – ou les premiers James Bond – pour les caches secrètes, les gadgets farfelus et la beauté des actrices. Et même si certains passages se révèlent un peu long – le film fait plus de deux heures – on s’amuse beaucoup à suivre ses aventures et on attend avec impatience la suite de celles-ci. V.P.

Virus-32 : des zombies qui passent la seconde
Y a pas à dire, ça fait toujours du bien un petit film de zombies/infectés. Car comme le dit l’adage : un film de zombie par semaine entretient la bedaine. C’est un proverbe gabonais. Mais aujourd’hui, il n’est plus possible de faire un film de zombie normal. Ou bien il doit être vraiment excellent comme Dernier train pour Busan. Il faut un détail en plus qui fasse l’originalité de la production. Comme l’humour corrosif et le fait que les héros soient des enfants dans Mexzombies par exemple. Et pour Virus-32, c’est le nombre 32 qui contient l’originalité du script.
Bon, mis à part ça, on ne va pas vous mentir, rien de bien nouveau sous le soleil des mort-vivants. La réalisation de Gustavo Hernández suit une mère (Iris) et sa fille (Renata alias Tata) qui vivent les débuts de l’apocalypse zombie depuis le lieu de travail de la maman. Et c’est bien sûr un vieil immeuble désaffecté sinon c’est pas drôle.
Même s’il ne verse pas forcément dans l’originalité, ce Virus-32 arrive à instaurer une belle tension dès ses prémices et continue ensuite sur la même lignée. Pas un seul moment de répit pour les personnages, les rencontres avec les infectés vont très vite se multiplier. Big up aussi pour la scène de l’accouchement d’une maman zombie même si Dawn of the Dead l’avait déjà fait. En résumé, un bon petit film à regarder avec des potes en soirée histoire de se détendre mais pas un chef d’œuvre qui restera gravé dans l’histoire du film du genre. O.E.

The Price we Pay : c’est qui Tamura ?
L’ennui quand on n’a que quelques séances de 00h30 dans le festival c’est que notre corps n’est plus forcément habitué à une telle rudesse. Comment ça vous me voyez arriver à des kilomètres ? Quoi ? Moi, m’endormir devant The Price we Pay ? C’est absurde voyons. Somnoler tout au plus.
Dirigé par Ryûhei Kitamura qui était élevé au rang de chevalier de l’Ordre du Corbeau juste avant la séance, le film suit une bande de gangsters qui s’enfuit d’un braquage en emmenant une otage avec eux dans leurs bagages. Et quand ils partent se planquer dans une ferme toute proche pour faire profil bas, ils vont faire entrer le scénario dans le côté Massacre à la Tronçonneuse de la Force.
La suite, vous la devinez : une famille bien sadique qui préfère passer ses samedis soirs à torturer des inconnus plus que de regarder Netflix et du sang, beaucoup de sang. Commencé sur un faux rythme, The Price we Pay nous rappelle parfois le dernier bébé de Kitamura passé au BIFFF : Downrange. Mais si, le sniper qui tire sur une bande de jeune en road trip. Vous le reconnaissois ? Démarré pied au plancher, il connaît comme son grand frère filmographique un moment de creux avant de repartir de plus belle pour un final survolté. Au final, un bon petit slasher qui tache beaucoup mais qui ne restera malheureusement pas très longtemps dans nos mémoires. Parce que grâce à ses cinq agents bio-actifs, Prox vous libère des tâches ménagères. Prox, la solution contre les tâches ! O.E.