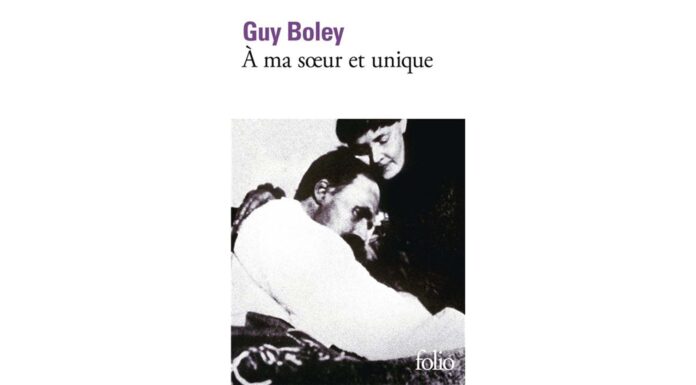Titre : À ma sœur et unique
Auteur.ice : Guy Boley
Edition: Folio
Date de parution : 13 mars 2025
Genre du livre : Biographie
Guy Boley retrace la vie de Friedrich Nietzsche et de sa sœur Elisabeth Förster dans ce livre familial rempli d’amour et de haine. L’auteur commence par cette scène emblématique de la vie du philosophe où il court à la rescousse d’un cheval battu, avant de sombrer dans la folie, jusqu’à sa mort quelques années plus tard. Puis, Boley reprend le cheminement classique de cette fratrie, de la naissance à la fin de vie, embarquant dans son récit leur mère, Franziska, avec qui Nietzsche restera « connecté » au travers de ses lettres nombreuses.
Le résumé et le titre du livre de Guy Boley sont trompeurs : si la sœur de Nietzsche est bien présente tout du long, elle figure au second rang jusqu’à la moitié du récit, quand son frère commence à ne plus raisonner comme avant. Elle devient la protagoniste les cent dernières pages, lors desquelles l’auteur allemand est alité et ne réagit plus que de manière aléatoire. Elle n’est donc au centre de l’histoire que lorsque son frère n’est plus vraiment capable d’agir, car il faut bien l’avouer, c’est son frère, et son intelligence exceptionnelle, qui capte toute l’attention.
À ma sœur et unique est évidemment passionnant pour cette biographie retracée de l’auteur de « Ainsi parlait Zarathoustra », qui toute sa vie soufra de douloureux maux de tête, de démangeaisons intestinales et d’une pauvre vue, tout en créant néanmoins l’œuvre qu’on lui connait. Boley nous donne accès à cette enfance allemande de cette seconde moitié du XIXème siècle comme s’il y était. Dramaturge de profession, ayant monté en scène un spectacle sur le sujet, il put bénéficier de toutes ses notes prises durant des années pour concocter un bouquin savoureux.
Le livre est accessible mais l’écriture de Boley peut toutefois faire achopper la lecture. C’est un bon écrivain conscient de son talent. Alors, en-veux-tu en voilà, ses pages ne seront que phrases interminables où il prouvera au monde des lettres qu’il n’est pas ici pour rire. Étalant ses connaissances, il tient à nous partager son érudition des lettres d’antan : un nombre incalculable de mots inconnus font donc leur apparition. Très souvent, trop souvent, il décide de coller l’une à la suite de l’autre des expressions toutes faites qui veulent dire la même chose, et même là, on sent qu’il a dû se retenir. En interview, il dit que le contenu du livre ne l’intéressait pas, que c’était le jeu sur l’écriture qui le fascinait. Or, c’est exactement cela qui par moments agace, son envie de se montrer, de parler des Dieux en s’exprimant en « nous », de digresser, qui fait que le roman aurait gagné à être resserré de cent pages pour se concentrer sur le pourquoi on souhaite le lire, à savoir pour son contenu, la relation entre Nietzsche et sa sœur Elisabeth.
Cela étant dit, quand il ne veut pas trop en faire, Boley est brillant et arrive avec le juste mot à communiquer ses idées de manière limpide. Il découpe son roman en dix parties, elles-mêmes subdivisées en plusieurs courts chapitres, tout en terminant par un épilogue. Ainsi, « À ma sœur et unique », contrairement à ce que la photographie faisant office de couverture laisse paraitre ou le nombre de pages illustrant cette épopée allemande bercée dans la foi et des manières d’antan, n’est jamais aride, que du contraire.
À ma sœur et unique rend compte de cette vie folle qu’a vécu Nietzsche, entrecoupée de maladie et de moments de grâce, soutenu de manière indéfectible par sa sœur qui était là pour le soigner, pour nettoyer ses vêtements et lui faire à manger lors de crises aigues, du moins avant qu’elle ne rencontre le monde aristocrate et Cosima, femme de Wagner. Élu professeur exceptionnel à l’université de Bâle à 25 ans, Nietzsche accepte ce contrat à contre cœur, tant son souhait n’est que d’écrire, écrire, écrire. Boley parvient à distiller certaines idées du philosophe dans cette biographie, notamment celles d’ « Amor Fati », d’apprendre à aimer son destin. Il prend garde toutefois à ne jamais mettre en parallèle ses œuvres et sa vie, et s’en tient donc surtout à ses faits et gestes quotidiens. On reste toutefois sur notre faim concernant son épopée post-université, lors de laquelle, aidé d’une pension offerte par le doyen malgré son jeune âge, il parcourt l’Europe en marchant et en écrivant ses œuvres les plus connues, durant plusieurs années.
Ensuite, sa sœur prend le relais et c’est là évidemment que son destin commence à fasciner et que Boley s’amuse à tourner la roue de la tragédie. Si Nietzsche est décrit comme un homme bon, tout consacré qu’il est à philosopher sur l’art et écrire, sa sœur, Elisabeth, bien qu’aimante, au contact de la bourgeoisie et de l’aristocratie, grâce aux amitiés de son frère, va affirmer sa personnalité opportuniste, essayant de rattraper ses années d’effacement où Nietzsche, seul garçon de la famille après la mort du père, était l’étoile qui faisait briller les yeux de leur mère et tantes.
Elisabeth aura une vie intrépide, se mariant avec Bernhard Förster, fasciné par Wagner et antisémite convaincu et convainquant les foules. Elle suivra cet homme jusqu’au Paraguay dans leur délire de créer une nouvelle Allemagne en terres latines, une Allemagne supposément débarrassée de la lie humaine qu’étaient les juifs. Alors qu’il mourra là-bas, dans le désarroi, Elisabeth, après avoir fait de la propagande pour envoyer des colons outre atlantique et prétendre que leur entreprise était un succès, donnant des conférences dans tout le pays germanique, réalisera que ce qui intéresse les gens, ce n’est pas son mari mais son philosophe de frère. Changeant de fusil d’épaule, son frère étant déjà alité, elle se chargera de capitaliser sur l’œuvre gigantesque de Nietzsche, toujours dans l’optique opportuniste de se faire un nom et surtout de vivre de manière fortunée, monnayant même l’accès au lit de son frère malade. Tant qu’elle peut faire de l’argent, elle en fera, et ce jusqu’à sa mort, à plus de 85 ans.
Guy Boley, dans À ma sœur et unique, dépeint cette famille née dans un cercle ultra religieux, père pasteur, mère bigote, duquel surgira deux enfants qui s’aiment et se détestent, se soutiennent et profitent de l’autre. C’est une tragédie humaine grandiose, shakespearienne, réduite à une famille de trois personnes, le père mourant jeune, où l’on souhaite la mort de l’autre d’un côté tout en le retenant de mourir de l’autre. On suit cette histoire avec de grands yeux atterrés, à la fois surpris, tristes et admiratifs d’y entrapercevoir autant de visages que l’humain est capable d’offrir, du meilleur comme du pire.