
José Luis Munuera, on le voit dans votre biographie, vous avez souffert de la mode comics et mangas en Espagne. Pensez-vous qu’il n’y a plus qu’en France (ou en Belgique) où l’on puisse encore faire des histoires humoristiques ? Un esprit un peu old school ?
Non, pas du tout old school. La différence, c’est qu’il existe un style de bande dessinée franco-belge. Il y a un savoir-faire très spécifique dans ces deux pays. En Espagne, cela n’existe pas.
Dès lors, l’Espagne, par manque de tradition en la matière, a très vite abandonné les méthodes plus anciennes pour les comics et les mangas.
Voulez-vous dire que le milieu de la bande dessinée n’est pas développé en Espagne ?
Non. Il faut savoir qu’il n’y a aucun endroit dans le monde où la bande dessinée prend une aussi grande place qu’en Belgique. Pour un dessinateur, la Belgique est un parc d’attraction exceptionnel.
Quelles sont vos influences ?
Justement, la bande dessinée franco-belge classique comme Uderzo, Morris, Franquin, Peyo, etc. Mais je suis également inspiré par les mangas ou les comics. Même si ce n’est pas la base de mon dessin, cela se ressent au travers de mon travail.
Vous avez travaillé jadis avec Joan Sfar et surtout Jean-David Morvan (Spirou et Fantasio). Qu’est-ce que ces personnes ont pu vous apporter ?
Beaucoup de choses. Ils ont des univers très différents mais c’est cela qui est intéressant. C’était parfois éloigné de mon propre univers mais cela m’a permis de m’ouvrir. Le travail de collaboration entraîne également une amitié et un apprentissage mutuel.
J’aime beaucoup travailler avec ces deux scénaristes car il y a un jeu de miroir, une double lecture de la création, puisque l’on peut aborder une bande dessinée sous plusieurs optiques différentes.
Est-il est difficile de reprendre une saga comme celle de Spirou et Fantasio ?
Oui, c’est très difficile. C’est une saga qui est importante aux yeux des gens. De nombreux lecteurs ont un vécu lié à Spirou, surtout en Belgique. En partant de ce postulat, tu peux faire ce que tu veux, ce ne sera jamais bon. Tu n’arriveras jamais au niveau où certains lecteurs ont placé ce personnage culte.
Tu ne pourras jamais être aussi bon qu’un Franquin ou un autre génie de la bande dessinée.
Hormis cette pression, il y a également celle qui est imposée par la maison d’édition pour la bonne et simple raison que les enjeux sont très importants.
Passé tout cela, il reste une partie d’inconscience et de bêtise qui te permettent de raconter une histoire comme n’importe quelle autre. C’est une réelle aventure.
Parlons maintenant des Campbell, votre nouvelle bande dessinée. Dans cette dernière, on suit l’histoire de plusieurs pirates très caricaturaux. Pourquoi avoir fait le choix d’exagérer les personnages ?
Dans la représentation graphique du pirate, on a cette image d’un personnage excessif et pittoresque. Ensuite, je pense que l’exagération est typique du langage de la bande dessinée. On peut exagérer les traits de caractère sans que cela sonne faux pour autant.
C’est justement l’inverse au cinéma, si on caricature les personnages à l’excès, cela ne passe pas.
En outre, je souhaitais pour ma part jouer avec les clichés, j’adore ça.
En lisant votre bio, on remarque votre travail sur la bande dessinée tirée du film d’animation de DreamWorks, Sur la route d’Eldorado. Nous avons eu l’impression de revoir les traits de caractère des deux protagonistes de ce récit au travers de Campbell ou Carapepino. Est-ce voulu ou fortuit ?
Non, ce n’est pas voulu. Je suis cependant très à l’aise entre les liens qui peuvent se faire entre le dessin animé et la bande dessinée. Même si ce sont deux univers différents, ils ont un langage commun très fort : le dessin.
En partant de ce postulat, je pense qu’il y a effectivement des liens que l’on peut faire assez facilement.
Comment avez-vous imaginé vos personnages ?
Je les vois comme des acteurs en train de jouer un rôle. Pas un acteur en particulier mais plutôt comme un style d’individu.
L’île des lépreux fait totalement partie de l’imaginaire. Souhaitiez-vous par là donner un aspect un peu fantastique à votre récit ?
Je pense que c’est une des pistes que le monde de la piraterie nous propose. Dans l’inconscient collectif, la piraterie, c’est le monde de l’aventure imaginaire et fantastique. Cela en devient presque sa définition, il n’y a qu’à regarder la saga Pirates des Caraïbes ou l’Ile au Trésor pour s’en rendre compte.
Le pirate est un personnage du fantastique à part entière. On parle de récits avec des monstres, des sirènes, etc. Dès lors, l’île des lépreux s’inscrit un peu dans la même lignée.
En outre, il fallait que je parle des gens qui se situent en dehors de la société. Un pari difficile puisque les pirates sont eux-mêmes des gens en dehors de la société. J’ai donc été plus loin encore dans la pensée.
Les lépreux sont très importants. Ils m’ont permis de parler de l’argent, de la culture, de la différence, de la philosophie, etc.
Les lieux, de même que le phrasé des personnages, sont intemporels. Je pense notamment aux deux fillettes présentes dans l’histoire. Seuls les costumes des personnages le sont. Est-ce une volonté de donner une tonalité plus actuelle à une histoire de piraterie ?
Tout à fait. Pour les deux filles, je m’inspire de mon propre entourage, c’est pour cela qu’elles ont l’air très contemporaines.
Mais il est important de souligner qu’il n’y a pas de connotation historique dans Les Campbell. Je ne me prétend pas historien et je ne souhaitais pas créer une histoire fidèle au passé. Il y a d’excellentes bandes dessinées uniquement axées sur l’histoire. Personnellement, je raconte une histoire imaginaire avec des pirates, c’est tout.
D’ailleurs, c’est pour cela qu’il n’y a pas d’endroit réel. Cela se passe dans un lieu imaginaire.
Plus simplement, comment vous est venue l’idée de proposer une histoire de pirates ?
Au départ, c’est une commande faite par mon rédacteur en chef. Il m’a demandé de réaliser cinq pages mettant en scène des pirates. Il a eu une très bonne intuition car cela a fonctionné immédiatement.
Par contre, le projet initial était de faire des histoires courtes sans forcément qu’elles aient un lien entre elles. De mon côté, je dois avouer que j’ai un peu piégé mon rédac’ chef en ajoutant à l’histoire une ligne de fond, une continuité. Ce qui a abouti à la bande dessinée que l’on connaît aujourd’hui.
Est-ce difficile d’être à la fois scénariste et dessinateur ?
Non, ce n’est pas plus difficile. La seule chose qui change, c’est que l’on travaille en solo et on perd le regard de l’autre. Le pari est donc plus risqué en quelque sorte.
Maintenant, il faut savoir que lorsqu’un scénariste et un dessinateur travaillent ensemble, le dessinateur a son mot à dire sur l’œuvre. Même s’il image ce qu’on lui propose par écrit, il garde une certaine liberté quant à la façon de le présenter. En tant que dessinateur, tu racontes l’histoire tout comme le scénariste.
Un deuxième tome va bientôt paraître si je ne me trompe. Combien de tomes sont prévus en tout ?
J’ai une idée d’histoire bien précise en tête mais je ne sais pas encore jusqu’où on pourra aller. Cela dépendra de la maison d’édition. Pour l’instant, trois tomes sont prévus au minimum. De mon côté, je pense que cinq tomes seraient les bienvenus pour pouvoir raconter tout ce que j’ai imaginé.
Travaillez-vous sur d’autres projets actuellement ?
Oui. Je travaille avec le scénariste belge Jean Dufaux sur une série qui s’intitule Sortilèges. C’est un conte pour adultes dont nous allons sortir un troisième tome dans deux ou trois mois.
Cliquez ici pour lire la critique des Campbell de Munuera



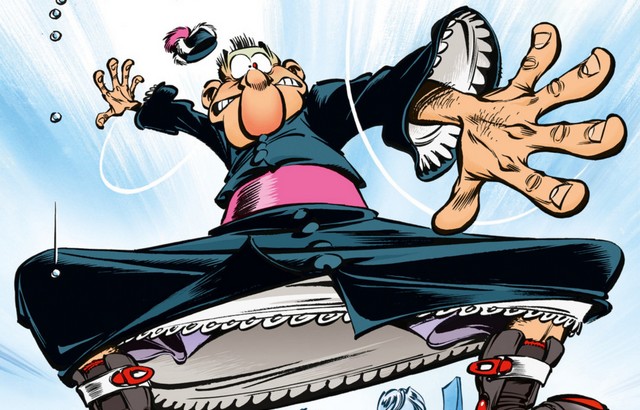
Laisser un commentaire